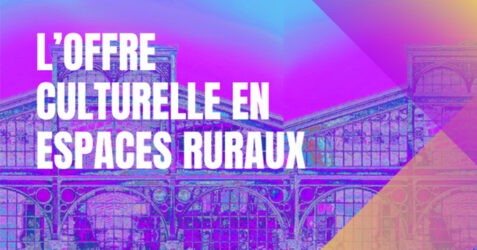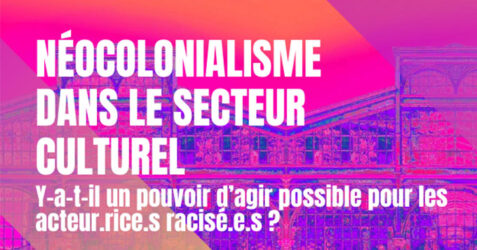Saveurs du Portugal

Passe ton bacalhau d'abord !
À l’occasion de festival Food Temple Portugal qui aura lieu du 23 au 25 septembre 2022 au Carreau du Temple, vous êtes invités à l’ouest de la péninsule ibérique pour nous partager les saveurs du Portugal !
L’objectif de cette thématique ? Récolter des photos de culture, marchés, restaurants, cuisine aux saveurs du Portugal. À vous de nous partager les délices gustatifs : croquettes de morue, pastéis de nata, ou encore un onctueux bacalhau à brás. Nous voulons entrer dans vos cuisines, découvrir ses moments et ses saveurs… Partagez-nous l’ambiance du Time Out Market ou la beauté d’un azulejo… Nous sommes aussi gourmands que curieux.
Comment participer ?
- Créer un compte gratuit sur la plateforme Wipplay
- Téléverser les photographies (formats autorisés : jpeg, gif, png) sans limitation
Quels sont les prix à gagner ?
- Prix du jury : exposition de la photographie lors de Food Temple Portugal, le livre Le Carreau du Temple d’une valeur de 35€ et une invitation pour deux personnes sur l’un des spectacles de la saison 22-23 du Carreau du Temple.
- Prix des internautes : le livre Le Carreau du Temple d’une valeur de 35€ et une invitation pour deux personnes sur l’un des spectacles de la saison 22-23 du Carreau du Temple.
Dates clés du concours :
- Début du concours : mercredi 11 mai 2022
- Fin du concours : mercredi 22 juin 2022
- Annonce des lauréats : début juillet 2022
Lire la suite
L’offre culturelle en espaces ruraux
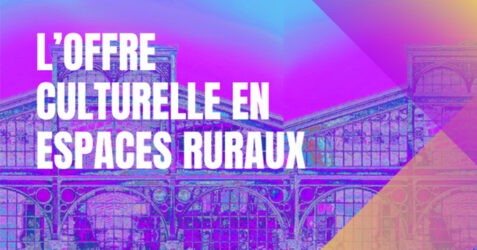
Les territoires représentent des espaces de convergence, d’inégalités, de flux, de rencontres ou de non-rencontres. Dans l’imaginaire collectif, la culture et les initiatives culturelles sont généralement associées aux territoires des grandes villes. Dans ce contexte, cette rencontre portera sur les actions culturelles dans les espaces ruraux. Nous verrons que ces territoires, à juste titre ou non, sont vus comme culturellement délaissés. En réalité, ces territoires regorgent d’initiatives et d’acteur.ice.s ayant le souci de mettre en valeur les spécificités des espaces ruraux et de s’y adapter.
Quelles sont les problématiques propres aux espaces ruraux, et quelles sont les réponses apportées ? Quel rôle la société civile et les institutions jouent-t-elles ? De quelles manières peuvent-elles influer ? Quel(s) public(s) pour cette offre culturelle en espace rural ?
À toutes ces questions s'attellera celle des financements, essentiels à l’organisation de projets et d’événements culturels. Ce volet économique nous permettra de montrer que l’obtention de financements et de subventions peut être intimement liée à des conflits et des rapports de force. Entre répartition inégale des ressources financières et comptabilité d’humeur, nous tenterons donc d’évoquer les frictions qui existent et la notion de pouvoir.
Sixième et dernière session des Rencontres de la Sorbonne sur la thématique "L’offre culturelle en espaces ruraux"
Lire la suite
Émancipation culturelle dans l’enfermement carcéral

Le savoir, c’est le pouvoir. L’accès à la culture, c’est l’aspiration à la liberté.
Cette conférence a pour but de déconstruire cette contradiction fondamentale du droit à la culture, à la liberté et au pouvoir dans ce lieu d’enfermement qu’est la prison. « Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude » affirmait Albert Camus en 1951. Il soulevait alors le lien profond entre culture et liberté. La culture est ouverture au monde, curiosité, prise de conscience de la complexité du réel, et pouvoir de création d’une opinion libre. Elle est un moyen de se connaître soi-même, mais aussi de connaître les autres et de les comprendre. C’est dans cette conception que s’ancre la notion de « droits culturels », qui désigne le droit fondamentalement humain d’être libre de vivre et de participer à la vie culturelle. C’est au nom de ces droits que des activités culturelles sont organisées dans les établissements pénitentiaires français depuis 1985. La culture s’est imposée comme outil essentiel à la cohésion sociale dans les prisons, au bien-être des détenus ainsi qu’à leur réinsertion, et plus largement, à la reconstruction de leur identité. Une démarche honorable mais qui peut aussi paraître contradictoire dans des établissements qui sont a priori des lieux d’isolement du reste de la société. Comment concilier émancipation culturelle et enfermement carcéral ? Libération des esprits et emprisonnement des corps ?
Au travers de cette conférence, nous chercherons à interroger les liens entre Culture et Pouvoir au sein du milieu carcéral. Qu’est-ce que la culture en milieu carcéral ? Qu’est-ce que la culture « du » milieu carcéral ? Et comment les activités culturelles en prison sont-elles effectivement facteur d’intégration et de cohésion sociale ? Dans quelle mesure les activités en prison sont-elles génératrices de nouveaux rapports de pouvoir et de hiérarchie entre les détenus ? La culture en prison sert-elle vraiment l’émancipation des détenus ? Et serait-il légitime de penser qu’elle est en réalité un moyen déguisé pour contrôler les détenus ? L’objectif de cette conférence est d’interroger autant les productions culturelles propres aux prisons et aux lieux d’enfermement que les interventions culturelles entreprises par les institutions et leur impact sur la culture carcérale.
Cinquième session des Rencontres de la Sorbonne sur la thématique "Émancipation culturelle dans l’enfermement carcéral : trouver le pouvoir, se réinventer"
Lire la suite
Culture Drag, un art militant au défi du genre

Cette conférence a pour objectif de réfléchir aux enjeux politiques liés à la représentation des rapports de genre à travers la culture drag. Le drag fait désormais partie intégrante de la culture populaire. Passée d’une niche au mainstream, cet art militant est devenu une pratique répandue qui s’articule essentiellement sur la mise en scène et la réarticulation des codes de genre.
Eminemment politique, la culture drag investit les codes du genre et des lectures transgressives des codes sociaux du genre. Parallèlement à cet effet de contestation politique, l’inclusion du drag dans la culture mainstream entraîne un effet de capitalisation de cet art. De là les questions qui animeront ce débat : faut-il se réjouir de l’accueil que la culture hégémonique réserve à ces objets et qui fait connaître au grand public ces minorités encore underground il n’y a pas si longtemps ou bien faut-il redouter que ce passage dans le mainstream ne vienne détruire leur dimension politique, militante et transformer cet art subversif en marchandise culturelle ?
Troisième session des Rencontres de la Sorbonne sur la thématique "Culture Drag, un art militant au défi du genre".
Lire la suite
Néocolonialisme dans le secteur culturel
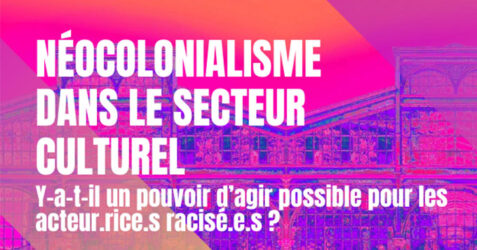
“ La race biologique n’existe pas, la race est un rapport social par lequel des groupes sont assignés à une identité et un statut qui justifie leur position dominée dans les rapports sociaux "1 (Didier et Éric Fassin). Les rapports 1 de domination raciale s’expriment et s’expérimentent dans toutes les sphères sociales. La sphère culturelle, évidemment, n’y échappe pas. À plusieurs échelles nous pouvons observer les mécaniques à l’œuvre, là où la culture reproduit des rapports de pouvoir de race. La dynamique des rapports sociaux nous conduit aujourd’hui à nous interroger non plus sur une absence, mais sur une forme de présence particulière, qui semble presque paradoxale. Si nous avons assisté, ces dernières années, à une multiplication des saisons culturelles mettant en avant les personnes racisées, il semble toutefois important de se poser la question de « qui » profite réellement de cette visibilisation soudaine. Entre réécriture de l’histoire, exotisation, et spoliation, l’instrumentalisation des productions culturelles des personnes racisées apparaît aujourd’hui encore comme vitrine d’une inclusion globale aux contours flous et aux objectifs parfois opaques.
Cette rencontre vise à questionner les dynamiques de pouvoir à l’œuvre et le rôle que l’assignation raciale joue dans l'écosystème artistique, institutionnel et culturel. L’inclusion des productions culturelles des personnes racisées, est-elle une nouvelle forme d’exploitation coloniale – un néocolonialisme – qui ne dit pas son nom ? Dans quelle mesure, cette inclusion « conditionnelle et conditionnée par l’assignation raciale » limite la capacité d’agir des acteur·rice·s racisé·e·s ?
1 Clerval Anne, « Rapports sociaux de race et racialisation de la ville », Espaces et sociétés, 2014/1-2 (n° 156-157), p. 249-256. DOI : 10.3917/esp.156.0249. URL : https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2014-1-page-249.html
Deuxième session des Rencontres de la Sorbonne sur la thématique "Néocolonialisme dans le secteur culturel : y-a-t-il un pouvoir d’agir possible pour les acteur·rice·s racisé·e·s ?".
Lire la suite
Repenser nos comportements écologiques

Les sociétés occidentales tentent tant bien que mal de développer une culture de l’écologie, une nouvelle façon d’être au monde en réponse à la gravité de notre situation environnementale et aux rapports scientifiques alarmants sur l’état de notre planète. Notre quotidien prouve ce désir d’être responsable tant par l’action des grandes institutions que par les initiatives citoyennes.
Mais si cette culture nouvelle, ces pratiques, ces modes de pensée, étaient en partie fondés sur des simulacres ? Une façon de s’auto-gratifier et de se dédouaner des événements catastrophiques qui surviennent, de façon à ne pas véritablement bousculer nos habitudes. N’y aurait-il pas, alors, une forme de mythe de l’écologie ? Au travers de cette rencontre, nous chercherons à démontrer et à questionner l’effet de tels comportements écologiques comme élément de gratification si ce n’est comme mode. Du néocolonialisme encore présent dans des exploitations intensives dans les DOM TOM à l’écoblanchiment omniprésent dans les stratégies de communication marketing, notre culture de l’écologie semble se fonder sur une démarche environnementale qui oublie deux éléments essentiels de l’environnement que sont l’économie durable et le bien-être des sociétés.
Nos intervenants, convaincus qu’une culture nouvelle de l’écologie est possible, nous apprendrons à faire rimer écologie avec espoir. Notre équipe vous invite à venir repenser nos comportements écologiques, à dépasser notre impuissance face aux changements du monde, à questionner nos pratiques et croyances et, ainsi, à reprendre le pouvoir de notre culture.
Session inaugurale des Rencontres de la Sorbonne sur la thématique "Repenser nos comportements écologiques : pour une révolution environnementale et culturelle".
Lire la suite
L’inclusion du handicap dans le monde culturel

Au sein des divers secteurs de la culture, les personnes en situation de handicap sensoriel sont marginalisées du fait de l’absence d’une offre culturelle appropriée et de l’incapacité d’inclusion du monde professionnel. Dans ce « désert » culturel produit par l’offre orientée uniquement vers les publics valides, les artistes et les publics en situation de handicap sont devenus les acteurs de nouvelles actions culturelles.
Dans le cadre du cycle de conférences sur le thème « Culture et Pouvoir » proposée cette année au Carreau du Temple, nous avons souhaité consacrer une séance à la condition des personnes atteintes de troubles sensoriels et à leur rapport à la culture. Le handicap sensoriel (l’atteinte d’un ou plusieurs sens) concerne 11,4 % des Français, soit 1,5 million de personnes non voyantes ou malvoyantes et environ 6 millions de personnes ayant une déficience auditive.
Malgré ces chiffres relativement importants, l’inaction des structures culturelles en termes d’inclusivité reste plus que flagrante. Ce manque d’inclusion est d’autant plus regrettable qu’il prive le monde de la culture d’une force créatrice trop longtemps invisibilisée et qu’il limite l’accès à la culture à une partie non négligeable de la population. Le fait que la différence sensorielle soit toujours pensée en termes d’un « manque » qu’il faudrait combler n’y est sans doute pas pour rien : dans ce contexte, la diversité sensorielle n’apparaît pas comme une richesse, mais comme une limite, occultant ainsi l’émergence de nouvelles possibilités de création qui sont pourtant sous nos yeux, comme le montre l’expérience des personnes ayant des troubles sensoriels devenues productrices d’une offre culturelle riche et diverse.
La conférence sera accessible aux personnes sourdes et malentendantes.
Quatrième session des Rencontres de la Sorbonne sur la thématique "L'inclusion des personnes handicapées dans le monde culturel"
Lire la suite
Les Rencontres de la Sorbonne 2021-2022

La traversée des différents confinements et contraintes imposés par la situation sanitaire cette dernière année a renouvelé le regard sur la question de la culture comme "produit de première nécessité". Mais de quelle culture parlons-nous ?
Dans un monde de plus en plus transformé par le numérique, chacun d'entre nous est appelé à reconsidérer les positions relatives des différents acteurs culturels et le pouvoir qu’ils exercent à l’aune de la pléthorique offre en ligne. Cet environnement engage à repenser les dynamiques et les tensions dans un paysage politique qui voit émerger diverses formes de contestation des cultures et des savoirs officiels.
Dès lors, la question du pouvoir de la culture et des cultures se pose avec urgence, qu'il s'agisse de la culture en tant que secteur économique et à son influence sur l’adhésion ou sur l’opposition politique, ou en tant que mode de vie, a fortiori dans une période de crise qui pointe l'importance de représenter des cultures et des expressions trop longtemps ségréguées et oubliées.
Répondant à cet appel à l’action, le cycle de visio-conférences que proposent les étudiantes et étudiants du Master 1 Direction de projet ou d’établissement culturel de l’École des Arts de la Sorbonne -sous la direction de Marco Renzo Dell’Omodarme, Maître de conférences- invite à explorer la dimension culturelle du pouvoir et, réciproquement, la puissance des cultures.
Cycle thématique de débats-conférences accueilli pour la sixième saison au Carreau du Temple, Les Rencontres de la Sorbonne proposent cette année d'étudier les dynamiques entre culture et pouvoir.
Lire la suite