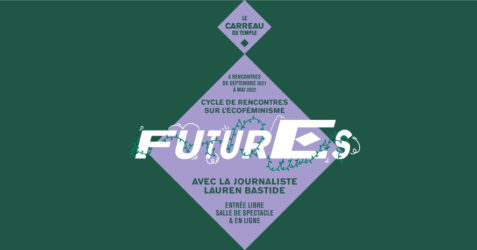Repenser nos comportements écologiques

Les sociétés occidentales tentent tant bien que mal de développer une culture de l’écologie, une nouvelle façon d’être au monde en réponse à la gravité de notre situation environnementale et aux rapports scientifiques alarmants sur l’état de notre planète. Notre quotidien prouve ce désir d’être responsable tant par l’action des grandes institutions que par les initiatives citoyennes.
Mais si cette culture nouvelle, ces pratiques, ces modes de pensée, étaient en partie fondés sur des simulacres ? Une façon de s’auto-gratifier et de se dédouaner des événements catastrophiques qui surviennent, de façon à ne pas véritablement bousculer nos habitudes. N’y aurait-il pas, alors, une forme de mythe de l’écologie ? Au travers de cette rencontre, nous chercherons à démontrer et à questionner l’effet de tels comportements écologiques comme élément de gratification si ce n’est comme mode. Du néocolonialisme encore présent dans des exploitations intensives dans les DOM TOM à l’écoblanchiment omniprésent dans les stratégies de communication marketing, notre culture de l’écologie semble se fonder sur une démarche environnementale qui oublie deux éléments essentiels de l’environnement que sont l’économie durable et le bien-être des sociétés.
Nos intervenants, convaincus qu’une culture nouvelle de l’écologie est possible, nous apprendrons à faire rimer écologie avec espoir. Notre équipe vous invite à venir repenser nos comportements écologiques, à dépasser notre impuissance face aux changements du monde, à questionner nos pratiques et croyances et, ainsi, à reprendre le pouvoir de notre culture.
Session inaugurale des Rencontres de la Sorbonne sur la thématique "Repenser nos comportements écologiques : pour une révolution environnementale et culturelle".
Lire la suite
L’inclusion du handicap dans le monde culturel

Au sein des divers secteurs de la culture, les personnes en situation de handicap sensoriel sont marginalisées du fait de l’absence d’une offre culturelle appropriée et de l’incapacité d’inclusion du monde professionnel. Dans ce « désert » culturel produit par l’offre orientée uniquement vers les publics valides, les artistes et les publics en situation de handicap sont devenus les acteurs de nouvelles actions culturelles.
Dans le cadre du cycle de conférences sur le thème « Culture et Pouvoir » proposée cette année au Carreau du Temple, nous avons souhaité consacrer une séance à la condition des personnes atteintes de troubles sensoriels et à leur rapport à la culture. Le handicap sensoriel (l’atteinte d’un ou plusieurs sens) concerne 11,4 % des Français, soit 1,5 million de personnes non voyantes ou malvoyantes et environ 6 millions de personnes ayant une déficience auditive.
Malgré ces chiffres relativement importants, l’inaction des structures culturelles en termes d’inclusivité reste plus que flagrante. Ce manque d’inclusion est d’autant plus regrettable qu’il prive le monde de la culture d’une force créatrice trop longtemps invisibilisée et qu’il limite l’accès à la culture à une partie non négligeable de la population. Le fait que la différence sensorielle soit toujours pensée en termes d’un « manque » qu’il faudrait combler n’y est sans doute pas pour rien : dans ce contexte, la diversité sensorielle n’apparaît pas comme une richesse, mais comme une limite, occultant ainsi l’émergence de nouvelles possibilités de création qui sont pourtant sous nos yeux, comme le montre l’expérience des personnes ayant des troubles sensoriels devenues productrices d’une offre culturelle riche et diverse.
La conférence sera accessible aux personnes sourdes et malentendantes.
Quatrième session des Rencontres de la Sorbonne sur la thématique "L'inclusion des personnes handicapées dans le monde culturel"
Lire la suite
Les Rencontres de la Sorbonne 2021-2022

La traversée des différents confinements et contraintes imposés par la situation sanitaire cette dernière année a renouvelé le regard sur la question de la culture comme "produit de première nécessité". Mais de quelle culture parlons-nous ?
Dans un monde de plus en plus transformé par le numérique, chacun d'entre nous est appelé à reconsidérer les positions relatives des différents acteurs culturels et le pouvoir qu’ils exercent à l’aune de la pléthorique offre en ligne. Cet environnement engage à repenser les dynamiques et les tensions dans un paysage politique qui voit émerger diverses formes de contestation des cultures et des savoirs officiels.
Dès lors, la question du pouvoir de la culture et des cultures se pose avec urgence, qu'il s'agisse de la culture en tant que secteur économique et à son influence sur l’adhésion ou sur l’opposition politique, ou en tant que mode de vie, a fortiori dans une période de crise qui pointe l'importance de représenter des cultures et des expressions trop longtemps ségréguées et oubliées.
Répondant à cet appel à l’action, le cycle de visio-conférences que proposent les étudiantes et étudiants du Master 1 Direction de projet ou d’établissement culturel de l’École des Arts de la Sorbonne -sous la direction de Marco Renzo Dell’Omodarme, Maître de conférences- invite à explorer la dimension culturelle du pouvoir et, réciproquement, la puissance des cultures.
Cycle thématique de débats-conférences accueilli pour la sixième saison au Carreau du Temple, Les Rencontres de la Sorbonne proposent cette année d'étudier les dynamiques entre culture et pouvoir.
Lire la suite
FuturEs
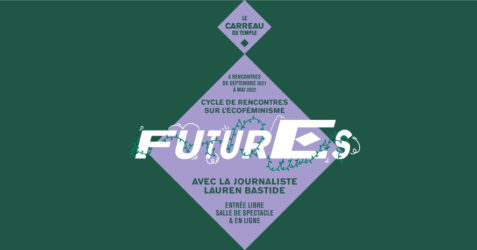
Bien avant que l’urgence climatique ne soit un sujet gouvernemental, bien avant que les Marches pour le Climat ne rassemblent des millions de citoyen·ne·s à travers le monde, des féministes ont conçu une pensée écologiste articulée avec la lutte contre les discriminations de genre.
Dès les années 70, en France, avec Françoise d’Eaubonne, ou aux États-Unis, avec Susan Griffin, des liens sont établis entre la domination exercée sur les corps des femmes et l’exploitation des ressources naturelles. Elles appellent cette pensée « écoféminisme ». L’écoféminisme n’est ni une école, ni un mouvement, c’est un flux foisonnant d’idées, de textes et surtout d’actions politiques qui a essaimé le monde entier. En révélant les relations entre patriarcat, capitalisme et colonialisme, il propose un retournement radical de ce que recouvrent le savoir, le pouvoir et les rapports sociaux. Grâce à l’action de grandes figures de cette pensée, comme celle de la philosophe et militante indienne Vandana Shiva ou encore de la penseuse et sorcière californienne Starhawk, il connaît ces dernières années un nouvel essor salutaire, et constitue un véritable espoir de construire un monde juste et durable pour les générations futures.
Au cours de ce cycle de huit conférences, Lauren Bastide entend s’entretenir avec les penseuses et activistes qui redonnent sa vitalité à la pensée écoféministe aujourd’hui. Sur la scène de la salle de spectacle, elles déconstruisent les mythes liés à ce mouvement, et explorent toutes les propositions qu’il recèle pour (re)construire l’avenir.
Sur scène et au micro de Lauren Bastide (podcast La Poudre), des chercheur·e·s, sociologues, historien·ne·s, économistes - qui pensent les rapports de genre, de race, de classe et de sexualité - nous aideront à mieux comprendre les systèmes d’oppression et surtout à mieux les combattre.
Lire la suite